Le Monde 2 août 2025 - PARIS-PÉKIN 1985 : IL Y A QUARANTE ANS, LE FABULEUX VOYAGE DE 400 ADOS AU PAYS DE MAO
- Francis MONNOT
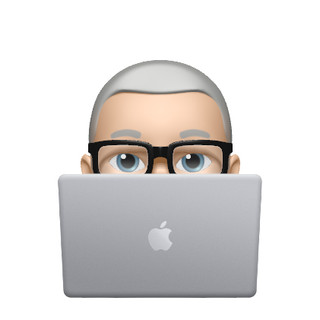
- 1 août 2025
- 14 min de lecture
Dernière mise à jour : 12 août 2025
Par Fabienne Maleysson
Le Monde édition du 2 août 2025

Le 2 juillet 1985, un train quittait la gare de Conflans-Sainte-Honorine dans une atmosphère de fête, destination Pékin. À bord, près de 400 Français de tous horizons, âgés de 15 à 25 ans, s’apprêtent à franchir le rideau de fer et à traverser les dictatures du bloc de l’Est. Dans les wagons, l’ambiance tourne vite à la colonie de vacances et au happening permanent. Cette formidable expédition raconte l’euphorie des années 1980 et la tentative d’ouverture d’une Chine alors en pleine mutation, qui a brutalement clos ce chapitre, quatre ans plus tard, sur la place Tiananmen.
Libérés par la foule massée sur le quai, des dizaines de ballons multicolores s’envolent dans un ciel sans nuages. Une ambiance aussi joyeuse que fébrile règne dans la gare de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) ce matin du 2 juillet 1985. Près de 400 jeunes âgés de 15 à 25 ans et une petite centaine d’accompagnateurs s’apprêtent à monter à bord d’un train mis à leur disposition. Leur direction finale ? Pékin ! Derniers adieux aux parents, dernières consignes d’usage écoutées d’une oreille distraite. On songe surtout à faire connaissance avec ses voisins de compartiment, avec qui on devra cohabiter pendant neuf jours.
Soudain, une bande d’olibrius déguisés en grooms s’allongent par terre devant la tribune pour figurer un tapis rouge et invitent Michel Rocard, maire (PS) de la ville, et Alain Calmat, ministre de la jeunesse et des sports du gouvernement de Laurent Fabius, à leur marcher dessus. Ce sont les comédiens du Théâtre de l’Unité, troupe anticonformiste – presque un pléonasme à l’époque –, qui sera du voyage pour animer les arrêts en gare. Le premier, à la gare Saint-Lazare, à Paris, est purement protocolaire : après quelques discours, le socialiste Jean Auroux, secrétaire d’Etat chargé des transports, coiffé d’une casquette de cheminot, donne un solennel coup de sifflet. C’est parti pour plus de 12 000 kilomètres de trajet à travers notamment la RDA, la Pologne et l’Union soviétique. Un voyage qui nous transporte, quarante ans après, au cœur des années 1980.
Franchir le rideau de fer, parcourir les dictatures du bloc de l’Est avec des centaines de jeunes armés d’appareils photos, des journalistes caméra au poing, bref une foule d’Occidentaux plus ou moins incontrôlables, ce défi n’a pu être relevé que parce que 1985 a été décrétée par l’ONU « Année internationale de la jeunesse ». On attend de tous les Etats qu’ils jouent le jeu. En France, l’ensemble des associations a été invité par le ministère de la jeunesse et des sports à présenter des projets. Sur les mille dossiers reçus, quatre cents ont été retenus, mais aucun n’est aussi décoiffant que celui-ci.
« Un fou hyperactif »
L’idée et sa réalisation, on les doit à l’imagination féconde et à l’énergie inépuisable de Claude Quenault, aujourd’hui âgé de 85 ans, alors directeur de la Maison des jeunes et de la culture de Conflans-Sainte-Honorine, et nommé pour l’occasion conseiller technique au cabinet d’Alain Calmat. « Un sacré bonhomme qui montait des projets que tout le monde considérait comme complètement dingues », se souvient Olivier Pasteur, un des artisans du séjour à Pékin, ancien représentant des Amitiés franco-chinoises. « Un fou hyperactif et grand séducteur », évoque Jacques Livchine, fondateur du Théâtre de l’Unité.

Un autodidacte aussi, enfant mal-aimé de parents qui l’avaient placé en orphelinat, puis ouvrier motoriste par défaut, devenu animateur socioculturel avant de décrocher le diplôme de directeur de MJC. Une idée à la minute et peur de rien, « il faisait partie de ces personnes qui, au début de l’ère Mitterrand, ont apporté un souffle nouveau dans le domaine culturel, salue Jean-Claude Thivolle, alors attaché à l’ambassade de France à Pékin. On dépoussiérait enfin les vieilles habitudes et, pour une fois, l’imagination était vraiment au pouvoir. » Radios libres et grands travaux, ministère du temps libre et fête de la musique, on connaît la chanson.
Claude Quenault s’inscrit dans la mouvance, crée le festival de café-théâtre de Conflans-Saint-Honorine avec des scènes improvisées dans les usines ou les cabines téléphoniques, puis emmène, en 1984, 600 jeunes Français et Québécois traverser l’océan Atlantique en paquebot pour échanger sur cet horizon mythique qu’on appelait encore « l’an 2000 ». A son retour, il se met en quête d’une idée pour l’Année internationale de la jeunesse.
La Chine, ce géant qui s’éveille et, selon la prophétie de l’ancien ministre et écrivain Alain Peyrefitte, promet de faire trembler le monde, exerce à l’époque une force d’attraction considérable. Et puis, prendre le Transsibérien, partir sur les traces de Michel Strogoff, de Tintin dans Le Lotus bleu, ça aurait de la gueule ! Alors, pourquoi pas un train pour Pékin ? Claude Quenault fait dessiner une affiche superbe, invente un slogan qui ne mange pas de pain (« Echangeons la paix, échangeons l’avenir »), s’assure de la coopération des Amitiés franco-chinoises…
Impossible de lui résister, d’autant que les sphères rocardiennes connaissent son talent pour mobiliser les jeunes. Seul le budget, 6 millions de francs, fait tiquer. Mais la Chine est un nouveau marché à conquérir, alors, pour compléter le million alloué par le ministère et les participations financières des voyageurs, les sponsors se précipitent. La liste a des allures de une des Echos version années 1980, où se côtoient entre autres Elf Aquitaine, le laboratoire pharmaceutique Roussel Uclaf ou encore la compagnie d’assurances UAP. L’affaire est rondement menée. La lecture du calendrier ferait pâlir d’envie tout organisateur confronté aujourd’hui à la surabondance de normes. La proposition est présentée au cabinet d’Alain Calmat le 18 octobre 1984. A la mi-novembre, le gouvernement donne son feu vert. L’équipe opérationnelle est aussitôt mise en place, la communication déployée sur tout le territoire et, sept mois plus tard, la « colo » géante investit le train… la veille de l’accord formel des autorités chinoises.
Smicards, étudiants, provinciaux…
Claude Quenault est persuadé que la génération qui sera aux manettes au tournant du siècle peut réaliser de grandes choses pourvu qu’on lui fasse confiance et qu’on l’incite à se bouger. Pour participer au voyage, chaque jeune a dû être capable de réunir les quelque
7 000 francs demandés, si possible en décrochant des petits boulots ou des subventions locales plutôt qu’en tapant dans les économies de papa-maman, mais aussi présenter, par petits groupes, un projet à réaliser à bord du train ou en Chine.
Un jury de jeunes membres de la MJC de Conflans-Sainte-Honorine a épluché les candidatures et sélectionné les heureux élus. Leurs propositions sont des plus éclectiques : certains prévoient un défilé de mode à l’arrivée avec des vêtements confectionnés pendant le trajet, d’autres comptent comparer la protection de l’ours des Pyrénées à celle du panda géant, écrire un story-board de bande dessinée sur le voyage et le faire illustrer par des étudiants des Beaux-Arts de Pékin, inaugurer une filière d’exportation de foie gras ou encore sauter en parachute dans le ciel de Chine.
Sans surprise, le grand ordonnateur tient à la mixité sociale. Embarquent aussi bien des élèves de lycées techniques que des étudiants de Sciences Po, des smicards de banlieue que des provinciaux venus d’Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques) ou de Saint-Florentin (Yonne). Parmi eux, il y veille, « des enfants d’immigrés ». Le métissage semble naturel pour des ados et jeunes adultes qui, cette année-là, ont placé en tête de leurs achats de 45-tours, outre les deux chansons pour l’Ethiopie – l’américaine et la française –, des morceaux qui claironnent « L’Aziza, ta couleur, tes mots tout me va » (Daniel Balavoine) ou « Je te donne toutes mes différences » (Jean-Jacques Goldman). Et dont certains arborent déjà, au revers de leur veste, un tout nouvel insigne, la main jaune siglée « Touche pas à mon pote » de SOS Racisme.
Un état d’esprit qui anime en revanche assez peu les douaniers est-allemands, qui, dans la nuit du 2 au 3 juillet, ordonnent la fermeture des portières, épluchent chaque passeport et font mine de vouloir retenir tous les voyageurs dont le patronyme a une consonance un peu trop africaine à leur goût. Claude Quenault bluffe : « Je suis le ministre, vous allez provoquer un incident diplomatique ! » Le convoi repart, bruissant de discussions scandalisées.


Depuis le matin, on a eu le temps de faire connaissance, la question « C’est quoi, ton projet ? » offrant un sujet de conversation tout trouvé. Chacun s’était vu attribuer une couchette précise, mais le bel ordonnancement n’a pas tenu une demi-journée. Les jeunes se sont regroupés par affinités, prenant possession des lieux sans trop d’égards pour les conventions. Témoin, le groupe d’artistes en herbe – dont un membre du collectif de graffeurs Les Frères Ripoulin – qui a peint une fresque bariolée à même les parois d’un wagon au grand dam de l’équipe encadrante.
Promis, on ne recommencera pas dans le Transsibérien, où les passagers et l’ensemble du matériel sont transbordés, le soir du 3 juillet, lors de l’arrêt en gare de Brest-Litovsk, à la frontière soviétique. Quatre heures durant, une escouade de douaniers examine avec un zèle poussé à l’extrême les effets personnels entassés dans les valises, le matériel des journalistes télé et radio, les médicaments, la ronéo (l’ancêtre de la photocopieuse) utilisée pour les projets de journaux de bord et jusqu’aux centaines de volumes de la bibliothèque dont ils se font lire des passages. Ne seront finalement confisqués que deux saucissons et un exemplaire du magazine érotique Newlook.
Vent de liberté
Si les peintres sont rentrés dans le rang, un vent de liberté souffle sur le train mythique, dont deux voitures ont été réservées aux spectacles et aux activités festives. Le personnel de bord, cuisiniers ou gardiens postés devant leur samovar à l’entrée de chaque wagon et qu’on soupçonne d’espionner les conversations, considère cette exaltation avec un mélange d’envie et de perplexité. « Si je dois retenir une image, c’est celle d’une fête perpétuelle, d’une énergie bouillonnante, d’une créativité incroyable, des idées qui fusaient sans cesse », raconte Bruno Sananès, à l’époque étudiant en gestion et aujourd’hui écrivain-voyageur (une vocation en partie due à cette aventure), parti avec l’idée d’élaborer un roman-photo à bord.


Certains travaillent à leurs projets, cousent des robes, donnent des cours de mandarin, impriment des articles pour Chine-Fizz ou Le Canard laqué, fabriquent des badges où figurent le prénom de l’acheteur et son équivalent chinois. « Pour d’autres, dont je suis, le projet est passé à la trappe. Personne ne contrôlait sa réalisation et nous voulions avant tout profiter de cette expérience extraordinaire », ajoute Bruno Sananès.
Alors on se lance dans des jeux de rôles, Donjons & Dragons ou Killer, on improvise un bœuf entre musiciens, un cours de gym tonic ou une séance de saute-mouton dans les couloirs, on organise un bal masqué où les draps tiennent lieu de toges, on va applaudir le Théâtre de l’Unité, qui joue dans son compartiment La Prose du Transsibérien, de Blaise Cendrars, on se rend aux rendez-vous fixés par la radio interne, qui crachote des petites annonces du style : « On manque de pions pour le jeu d’échecs humain. »


Dans un wagon, quelques spécimens au look affirmé décryptent leurs particularités respectives devant la caméra du réalisateur Frédéric Lepage, qui tourne un documentaire pour TF1. Défilent, le punk, coiffure en pétard et épingle à nourrice dans l’oreille, qui « lutte contre le racisme et les milices » ; le new wave, cheveux crêpés et rouge à lèvres noir, « dérivé du punk mais mieux intégré dans la société » ; le minet, jean 501 et chaussettes Burlington assorties à sa chemise Lacoste, un « hyperconformiste » qui écoute Police ; le baba, héritier des hippies, qui préfère Pink Floyd et professe des convictions écologistes ; le rockeur, en Perfecto et santiags, dont la philosophie se résume à Elvis Costello, AC/DC et Stray Cats. Un autre ado se lance dans un recensement des expressions en vogue chez ses contemporains : « il est trop », « ça galère, mais j’assure » ou l’énigmatique « ça craint velu ».
Des dizaines d’interviews permettent à Lepage de conclure que cette génération, « lucide, narcissique et pragmatique », est réfractaire aux grandes idées qui ont enflammé ses aînés et montre une soif d’entreprendre et même de réussir à tout prix inédite. Un peu plus d’un an auparavant, en février 1984, Yves Montand, ancien sympathisant communiste, a fait l’éloge de l’austérité et du libéralisme sur Antenne 2, dans l’émission « Vive la crise », retranscrite le lendemain dans Libération. Autant dire que la figure du yuppie, anglicisme tout juste adopté en France pour décrire un jeune cadre ambitieux, voire arriviste, n’est pas toujours regardée avec réprobation.


Le paysage ? On l’ignore superbement. À peine les reflets du lac Baïkal font-ils lever un sourcil. Tout le monde est trop occupé à travailler, à s’amuser ou à tomber amoureux. Les responsables de la logistique ont prévu le coup et emporté des caisses entières de préservatifs, précaution d’autant plus indispensable que le sida commence à faire des ravages. Des dizaines de couples se forment pour une éternité qui durera deux semaines. Le maelström d’émotions fait passer au second plan les habitudes quotidiennes.
« On se lavait quand on y pensait, avec un sac plastique rempli d’eau au petit robinet des toilettes. On sautait des repas d’autant plus volontiers qu’on en avait marre du menu concombre-saucisses-purée. Comme tout était calé sur l’heure de Moscou malgré les six fuseaux horaires traversés, on ne savait plus où on en était. En plus, on n’avait pas envie de louper quelque chose, donc on ne dormait quasiment pas et puis on tombait comme des masses pendant trois ou quatre heures malgré le bruit », se souvient Sandrine Halfen, partie à 19 ans après un an d’études de sociologie à Nanterre, dans l’espoir d’interroger les jeunes Chinois sur l’image qu’ils avaient de Mao…
Naïveté
Cette naïveté, la plupart des jeunes voyageurs la partagent, si l’on en croit les reporters embarqués. Aux arrêts en gare, où quelques minutes sont accordées pour se dégourdir les jambes, ils sont aussi surpris que déçus de ne pas pouvoir discuter librement avec les autochtones. De longs trains sont bien souvent positionnés sur une voie en guise de paravent pour éviter tout contact. Et, quand ce n’est pas le cas, des militaires veillent au grain, encadrant des citoyens russes aux mines tristes et aux allures austères.
« Remords tardifs d’avoir traversé une terre de bagne avec l’œil frivole de danseurs de tango en goguette », écrira Patrice Delbourg, le journaliste de L’Evénement du jeudi, à l’arrivée en Chine. Des remords vite oubliés quand, à l’approche de la frontière russo-chinoise, on perçoit une clameur qui tranche avec le lourd silence des gares soviétiques. Ce sont des centaines d’enfants, des petites filles en blanc, chouchous de tulle rouge dans les cheveux agitant des foulards fuchsia au rythme de la fanfare composée de garçons en uniformes vert bouteille.
Émus aux larmes, les voyageurs descendent saisir une petite main, esquisser une ronde, immortaliser ce moment qui reste gravé quarante ans après dans la mémoire de chacun. Deux jours plus tard, le 11 juillet, en gare de Pékin, une haie d’honneur du même acabit est postée sous une banderole : « Chaleureuse bienvenue à nos jeunes amis français ». Le soir même, les quelque 500 participants sont reçus en grande pompe au palais de l’Assemblée du peuple, où les attend un dîner de gala, reflet de la riche gastronomie chinoise. Un honneur habituellement réservé aux chefs d’État et aux ambassadeurs. Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, le premier ministre de la République populaire de Chine, Zhao Ziyang, un réformateur, en appelle à la jeunesse des deux pays pour que « l’arbre de l’amitié sino-française soit vigoureux et verdoyant d’âge en âge ».

Cet accueil exceptionnel témoigne des bouleversements à l’œuvre en Chine à cette période. Le voyage a lieu tout juste un an avant que Pékin demande de reprendre son siège au GATT, ancêtre de l’Organisation mondiale du commerce. La venue de ces jeunes Français, dont certains sont promis à un avenir de cadres dirigeants, est l’occasion d’afficher son souhait de développer les échanges. Mais la mue ne s’arrête pas là. « On ressentait un élan nouveau dans la société chinoise, une aspiration à l’ouverture vers l’étranger extraordinaire. La liftière de mon immeuble lisait du Balzac dans l’ascenseur ! », assure Jean-Claude Thivolle, l’un des organisateurs du séjour, en sa qualité d’attaché à l’ambassade de France à Pékin.
« De profondes mutations sont alors à l’œuvre, confirme le sinologue Jean-Philippe Béja. Le Parti communiste s’est lancé dans un programme de démaoïsation. En quête de légitimité, pour mener les réformes, il s’inspire beaucoup de ce qui est fait à l’étranger, ses cadres se rendent en Europe de l’Est, mais aussi en Occident, pour étudier les idées pertinentes. Dans le même esprit, on commence à inviter des étrangers en Chine et tout le monde, dans les instances dirigeantes comme dans la société en général, est très curieux de mieux connaître leur mode de vie. »
Sueurs froides
Les responsables de la Fédération nationale de la jeunesse chinoise qui coorganise le séjour sont, à raison, convaincus que cette curiosité est partagée. Pour autant, l’idée de laisser 400 chiens fous dans la nature leur donne des sueurs froides. Pour occuper la petite semaine sur place, un programme d’activités a été établi, auquel tous sont supposés se conformer le doigt sur la couture du pantalon. « Les Chinois sont très ponctuels et très stricts sur les horaires, tout retard entraînerait leur mécontentement », avertit le document qui décrit par le menu le déroulement du séjour. En vain. Grisés par la liberté expérimentée dans le train et épuisés par les nuits blanches successives, les jeunes sont peu motivés à l’idée de se lever au petit matin pour visiter une usine d’assemblage de postes de télévision, une aciérie, un hôpital ou un abri antiatomique.


La Grande Muraille ou la Cité interdite obtiennent davantage de succès. Surtout, après neuf jours de promiscuité imposée, chacun rêve de flâner à sa guise dans cette ville en pleine métamorphose, avec ses vieillards en col Mao côtoyant des étudiants en tee-shirt « Enjoy Coca-Cola », ses triporteurs surchargés passant devant chez Maxim’s et ses commerçants accroupis devant leurs étals de fortune, sous des affiches publicitaires pour Sony ou Siemens.
Pour ceux qui réussissent à s’affranchir des activités collectives, c’est le choc des cultures avec les habitants d’un pays longtemps coupé du monde. « J’avais les cheveux blonds décolorés et les yeux bleus. Un jour, dans un bus, des enfants se sont mis à pleurer parce qu’ils m’avaient pris pour un démon », raconte Valérie Santarelli, alors étudiante en histoire à Nice, partie à 20 ans pour documenter le voyage en photos.
« Les copains d’origine africaine fascinaient les habitants qui approchaient pour leur toucher les cheveux, ajoute Sylvia Minem-Christophe, tout juste revenue, à 19 ans, d’une année au pair à Londres et qui partageait avec Sandrine Halfen le projet d’interroger les jeunes sur le Grand Timonier. On a eu l’impression que le garçon qui était à notre table au banquet et nous avait gentiment proposé de nous faire visiter Pékin était plutôt ouvert, mais, quand on a commencé à lui parler de Mao, il s’est volatilisé », rigole-t-elle.
Courants contraires
Chacun peut le constater au fil des jours, la société est parcourue de courants contraires. Les étudiants des Beaux-Arts pataugent dans la peinture répandue à terre et les jeunes filles dansent le rock avec les Français au bal du 14 Juillet dans les jardins de l’hôtel, autant d’audaces inenvisageables deux ans auparavant. Mais on sert encore aux visiteurs des discours de propagande du style : « Pas besoin de droit de grève en Chine, les ouvriers sont tous heureux » ou « la délinquance est due à l’influence des idées venues de l’étranger ».

C’est aussi l’époque où les représentations de Carmen, donné à l’Opéra de Pékin sous la direction du metteur en scène français René Terrasson et prévu pour rester à l’affiche plusieurs semaines, ont été stoppées au bout de six jours. Quelques dinosaures du Parti avaient jugé l’histoire par trop subversive. « Cette anecdote est symbolique de cette période de bagarres permanentes entre réformateurs qui poussent vers l’ouverture sur l’Occident et conservateurs qui les accusent de s’embourgeoiser », commente Jean-Philippe Béja.
Quatre ans plus tard, en juin 1989, ces derniers finiront par l’emporter. Sur la place Tiananmen, où s’étaient tenus un défilé de mode, une démonstration de skateboard et un happening des comédiens du Théâtre de l’Unité bondissant sur leurs échasses au son d’une java, les étudiants réclamant la poursuite des réformes feront face à une répression féroce. Zhao Ziyang, partisan du dialogue avec les manifestants, sera démis de toutes ses fonctions et placé en résidence surveillée. Et la parenthèse durant laquelle tous les espoirs étaient permis, écrin idéal pour l’accueil de ces jeunes Français insolents de liberté, se refermera.
Fabienne Maleysson


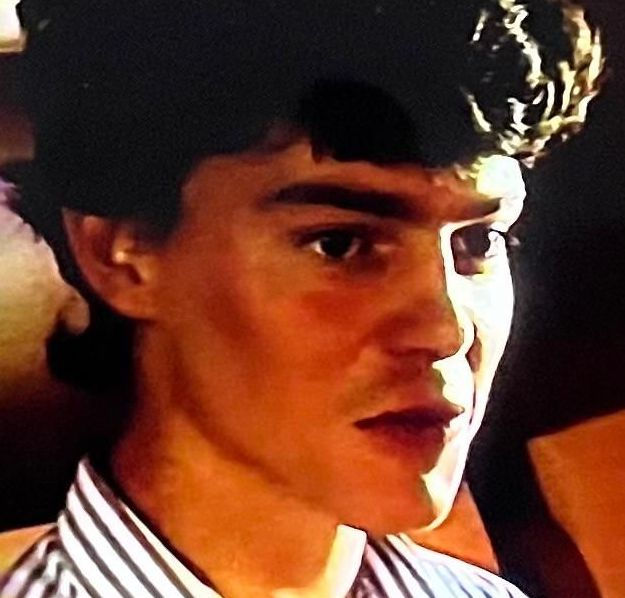









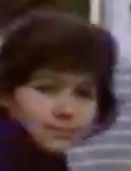







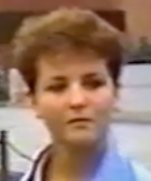



















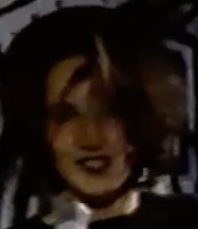















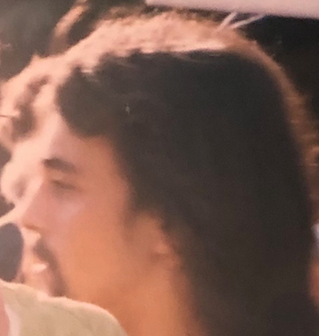


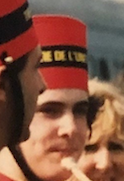
















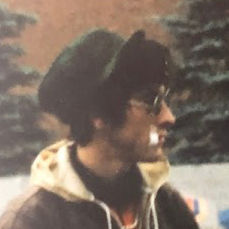








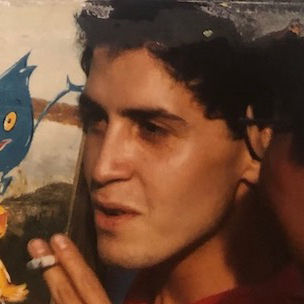








Quel honneur ! La Une du Monde ! Un bel article parfois un peu cliché à mon goût... mais de très belles photos 😎